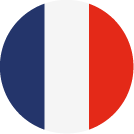Procédure de conciliation : qui peut en bénéficier ?
Toute entreprise, qu’elle soit commerciale, artisanale ou libérale, peut bénéficier d’une procédure de conciliation.
Ce dispositif s’adresse aux structures qui rencontrent des difficultés juridiques, économiques ou financières, mais qui ne sont pas encore en cessation de paiements ou qui le sont depuis moins de 45 jours.
L’objectif est de leur permettre d’anticiper la crise et de négocier un accord amiable avant que la situation ne devienne critique.
Une demande de procédure de conciliation peut être faite à la demande du ministère public ou du président du tribunal de commerce si le débiteur est une entreprise relevant de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé, conformément à l’article L.721-8, 4°.
Quelles sont les étapes d’une procédure de conciliation ?
Une procédure de conciliation se déroule en 4 étapes :
- Demande d’ouverture,
- Désignation du conciliateur,
- Période préparatoire de l’accord,
- Fin de la conciliation.
Ouverture d’une procédure de conciliation
L’ouverture d’une procédure de réglementation demande certaines démarches administratives. Voici les étapes essentielles.
À qui s’adresser ?
Pour ouvrir une procédure de conciliation, le dirigeant de la société doit déposer une demande :
- Au tribunal de commerce pour les entrepreneurs individuels ou lorsque la société exerce une activité commerciale ou artisanale. Accéder au formulaire d’ouverture de conciliation.
- Au tribunal judiciaire pour les entreprises exerçant une activité libérale.
Quelles sont les documents utiles ?
Le dossier de procédure de conciliation doit être accompagné des documents suivants :
- Une lettre explicative de la situation de l’entreprise, de ses besoins de financement et des actions mises en place pour y faire face,
- Une justification d’immatriculation de la société au Registre National des Entreprises (RNE) ou un extrait KBIS,
- Un état des lieux des créances avec un échéancier,
- Une liste des principaux créanciers,
- Une attestation sur l’honneur doit être fournie, certifiant qu’aucune procédure de conciliation n’a été engagée au cours des trois mois précédant la demande.
- L’état de l’actif et du passif des sûretés qui correspond aux garanties accordées aux créanciers pour le recouvrement des créances, ainsi que l’état des engagements hors bilan,
- Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l’actif réalisable et disponible, sans inclure les stocks et les productions en cours,
- Le passif exigible des trois derniers exercices doit être présenté si ces documents existent. Ils donnent une vision claire de l’évolution financière de l’entreprise et permettent de savoir si elle peut honorer ses dettes.
Important : la demande doit être écrite, datée et signée à la date du dépôt auprès du tribunal. Elle doit être envoyée en 2 exemplaires au Tribunal.
Depuis le 1er janvier 2025, les tribunaux de commerce de 12 villes ont été remplacés par des tribunaux des activités économiques (TAE).
Les villes concernées sont les suivantes : Avignon, Auxerre, le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.
Désigner un conciliateur
Une fois la demande reçue, le président du tribunal envoie une convocation au dirigeant de l’entreprise afin d’avoir des explications sur la situation.
Si la demande est acceptée par le Tribunal, il émet une ordonnance avec les éléments suivants :
- Identité du conciliateur,
- Objet de la mission,
- Rémunération du conciliateur,
- Durée de la procédure de conciliation.
Le conciliateur est donc désigné par le président du Tribunal concerné. Dans la plupart du temps, le conciliateur est un administrateur judiciaire.
Le conciliateur a pour mission d’assister les dirigeants d’entreprises pour mettre en place des solutions pour assurer une bonne continuité de l’entreprise. Le conciliateur élabore ensuite un protocole à négocier avec les créanciers afin d’obtenir un délai de paiement ou des remises de dettes.
Bon à savoir : en cas de ralentissement, le conciliateur peut demander une prolongation de sa mission.
La durée de la conciliation est de 4 mois maximum et peut être prolongée d’un mois.
Le conciliateur est payé par l’entreprise et est fixé en accord avec le dirigeant de celle-ci.
La période préparatoire avant la signature de l’accord
Durant cette période préparatoire le conciliateur et le chef d’entreprise élaborent une liste des créanciers tout en cherchant un moyen de résoudre les problématiques financières. L’objectif est de trouver un terrain d’entente avec les créanciers et l’entreprise.
L’entreprise en difficulté peut s’engager à prévoir une restructuration de ses activités, envisager de faire des crédits, procéder à des licenciements ou se séparer de certains biens non nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Du côté des créanciers, ils peuvent accorder des délais de paiement, des remises partielles ou totales des dettes. Seuls les principaux créanciers participent à la procédure de conciliation.
Bon à savoir : l’entreprise peut demander au Juge au cours de cette négociation un délai de paiement pouvant aller jusqu’à 2 ans.
La fin de la procédure de conciliation
Lorsqu’un accord est trouvé entre l’entreprise et ses créanciers, ils doivent procéder à une signature de l’accord ou de l’homologation de la procédure de conciliation. C’est ce qui acte la fin de la conciliation.
Lorsque le tribunal constate l’accord de conciliation il devient exécutoire, il doit donc officiellement être appliqué par les parties.
Les créanciers ne pourront donc pas poursuivre l’entreprise durant la durée de l’exécution de l’accord.
Bon à savoir : cette procédure est confidentielle et ne fait l’objet d’aucune publication. Les parties doivent donc respecter ce principe.
Lorsque l’entreprise en difficulté et ses créanciers souhaitent accorder une plus grande importance à leur accord, ils peuvent demander une homologation de celui-ci.
Les conditions sont les suivantes :
- L’entreprise qui rencontre des difficultés n’est pas en cessation de paiement,
- L’accord préserve également les intérêts des créanciers qui n’ont pas signé,
- L’entreprise en difficulté doit être tout de même capable de poursuivre son activité.
L’homologation permet d’offrir des avantages aux créanciers signataires qui apportent des fonds, des biens ou des services dans le cadre de l’accord. Ils deviennent donc prioritaires en cas de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire de la société en difficulté.
Bon à savoir : l’entreprise en difficulté doit prévenir le CSE du contenu de l’accord. Celui-ci doit également faire l’objet d’une publication au Bodacc ce qui rend la procédure publique.
Procédure de conciliation : que faire en cas d’échec ?
Lorsque qu’aucun accord n’est trouvé entre les parties dans les délais, la procédure de conciliation est clôturée. En cas d’échec, les négociations sont annulées. L’entreprise peut envisager d’autres recours.
Procédure de sauvegarde accélérée
Lorsque certains créanciers refusent de signer le projet d’accord, l’entreprise peut demander une procédure de sauvegarde accélérée.
Cette procédure permet d’imposer un plan de restructuration aux créanciers grâce à un vote en classes de parties affectées.
Pour bénéficier d’une procédure de sauvegarde accélérée il faut remplir les conditions suivantes :
- Être dans une procédure de conciliation,
- Ne pas être en cessation de paiement,
- Avoir au moins 250 salariés et un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 20 millions d’euros,
- Avoir un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 40 millions d’euros.
Ouverture d’une procédure de sauvegarde classique
Si l’entreprise n’est pas encore en cessation de paiements et qu’elle ne parvient pas à trouver un accord avec ses créanciers, elle peut demander au tribunal l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Cette procédure permet la poursuite de l’activité, le maintien des emplois et le règlement des dettes.
Le redressement ou la liquidation judiciaire
En cas de cessation de paiement, l’entreprise ne peut plus régler ses dettes avec son actif disponible. Le tribunal peut alors ouvrir une procédure de redressement judiciaire pour tenter de sauver l’activité. Si la situation est trop critique, une liquidation judiciaire peut être prononcée.
Procédure de conciliation : quels impacts sur les créanciers ?
La procédure de conciliation étant confidentielle, un créancier non convié peut être exposé sans le savoir. Seuls les créanciers stratégiques participent aux négociations, laissant les autres sans moyen d’action ni visibilité sur la situation du débiteur.
Pour se protéger, il est essentiel d’anticiper les risques en détectant les signes de difficultés d’un client : retards de paiement, demandes d’échéancier, baisse d’activité ou changement de comportement.
Avec CentralPay, vous pouvez automatiser le suivi et le recouvrement des factures. La plateforme détecte les retards, envoie des relances automatiques et optimise la gestion des encaissements. Vous gardez ainsi une visibilité claire sur les paiements et sécurisez votre trésorerie avant qu’une situation critique ne se déclare.